
Pierre Gagnaire – » je respecte la charte de la cuisine française : une belle veste blanche en coton d’Égypte, un tour de cou… Ce sont des symboles… Les vestes bariolées me font un peu hérisser. «
![]() À chaque fois que Pierre Gagnaire s’exprime c’est avec beaucoup de bon sens, un chef cuisinier qui de par son parcours a su garder les pieds sur terre. Un chef qui oeuvre au quotidien dans une réalité qu’il côtoie en étant auprès de ses collaborateurs.
À chaque fois que Pierre Gagnaire s’exprime c’est avec beaucoup de bon sens, un chef cuisinier qui de par son parcours a su garder les pieds sur terre. Un chef qui oeuvre au quotidien dans une réalité qu’il côtoie en étant auprès de ses collaborateurs.
Pour retrouver l’interview enregistré du chef de passage à La Baule – cliquez sur Kernews
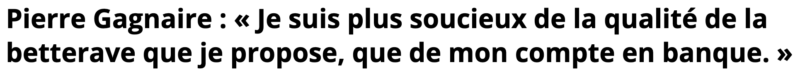
Pierre Gagnaire fait régulièrement le tour des établissements du Fouquet’s, dont il élabore les menus. C’est à l’occasion d’un passage au Fouquet’s de La Baule, à l’hôtel Royal Barrière, que nous avons rencontré celui que ses pairs surnomment « Le plus grand chef étoilé au monde ».
Kernews : La gastronomie traditionnelle française est-elle en train d’évoluer sous l’impulsion des jeunes chefs ?
Pierre Gagnaire : Elle a déjà évolué, parce qu’il y a plein de gens qui sont venus en France dans les années 80, beaucoup de Japonais, des Américains, ou des Italiens et, aujourd’hui, ces gens ont pris le meilleur de notre savoir-faire en le bidouillant à leur manière. La cuisine, c’est quelque chose de vivant. Elle a beaucoup changé aussi à cause des femmes, parce qu’elles travaillent énormément et elles apportent une sensibilité qui leur est propre, une douceur et une élégance.

La cuisine française figure dans le patrimoine de l’humanité : cela signifie-t-il qu’il faut aussi la protéger ?
Oui. Même dans ma façon de m’habiller, je respecte la charte de la cuisine française : une belle veste blanche en coton d’Égypte, un tour de cou… Ce sont des symboles… Les vestes bariolées me font un peu hérisser. En plus, nous faisons un métier qui doit transpirer la propreté, puisque nous sommes aussi responsables de la santé des gens que l’on nourrit, au-delà de la qualité de ce que l’on fait. La moindre des choses est déjà de ne pas les empoisonner… Donc, il faut déjà que, dans notre attitude, le consommateur ait le sentiment d’avoir en face de lui quelqu’un qui prend soin de sa mission.
Vous gérez de nombreux restaurants dans le monde, or vous connaissez chacun des produits proposés dans vos établissements. Comment faites-vous ?
Entre être un chef de cuisine et un chef d’entreprise, je suis d’abord un chef de cuisine. Je vis au milieu de mes équipes et je suis forcément informé de ce qu’elles font. Je suis plus soucieux de la qualité de la betterave que je propose, que de mon compte en banque. Je ne suis pas obsédé par les ratios ou la rentabilité : c’est d’ailleurs une philosophie qui m’a coûté cher, puisque j’ai tout perdu il y a 25 ans… Maintenant, je suis bien obligé de faire attention à l’argent que je dépense, mais je fais aussi très attention pour rester un homme qui vit sa cuisine au quotidien. Ce ne sont pas que des mots, c’est une réalité.
Lorsque l’on est arrivé au sommet de l’Everest, on sait que l’on va forcément redescendre un jour…
D’abord, nous sommes nombreux à être dans les premiers… La seule chose, c’est que je suis sur la scène depuis pas mal d’années, cela veut dire que mon histoire tient la route ! Après, il faut être à l’écoute des signaux et savoir un jour céder sa place. Peut-être que je ferai autre chose, ce serait une autre façon d’appréhender mon métier… Mais on verra. Je fais confiance à mon instinct pour trouver les bonnes solutions.
Comment avez-vous vécu la destruction du Fouquet’s sur les Champs-Élysées au moment des manifestations des Gilets jaunes ?
Dans l’imaginaire des gens, le Fouquet’s est une symbolique ridicule parce que, même à Paris, on peut déjeuner pour 80 euros au Fouquet’s ! Cela ne coûte pas une fortune, mais c’est comme cela dans l’imaginaire des gens, alors qu’il y a des établissements bien plus chers. Ce monde des Gilets jaunes a mal tourné, d’ailleurs toutes les révolutions tournent au vinaigre… Mais au départ, il y a des problèmes qui sont posés, c’est l’expression de gens délaissés, mal-aimés et qui ne sont pas respectés. Ce sont des gens qui ont été abandonnés sur le chemin de la mondialisation. Après, il y a la face cachée, avec d’autres personnes… Les Gilets jaunes, c’est comme la vache folle : on veut tirer, on veut tirer, mais on ne veut pas payer et puis, un jour, la chaîne sanitaire se rompt. C’est un peu ce qui s’est passé avec cette population qui a besoin d’être considérée, parce qu’il y a vraiment des gens qui rament. Parfois, en tant que chef d’entreprise, je me dis qu’il faut savoir faire un petit peu plus pour apporter la paix dans son entreprise. Mais on ne peut pas non plus aller trop loin, sinon je leur réponds : « Prenez les clefs, débrouillez-vous, je vais faire autre chose ! » Être chef d’entreprise, c’est un combat perpétuel entre le cœur et la raison. Ce n’est pas évident.
Gérer avec le cœur, pendant longtemps cela vous a coûté cher…
Ce n’était pas que le cœur, c’était aussi la folie d’un jeune type qui voulait donner du sens à ce métier. C’était vraiment une thérapie. Malheureusement, aujourd’hui, beaucoup de gens ne savent pas où ils vont. En faisant bien son travail, même en gagnant 1500 euros par mois, on peut trouver un sens à sa vie et puis, progressivement, monter dans l’échelle sociale. La seule chose, c’est qu’il faut se faire mal, être mobile, bouger et il faut accepter de sortir régulièrement de sa zone de confort. C’est ce que je fais encore. Si j’ai tous ces restaurants, ce n’est pas pour être riche, car je ne serai jamais riche, mais c’est d’abord un moyen pour moi de verbaliser ma cuisine en ayant la capacité d’expliquer ce process mental qui m’est propre. Je fais tout cela aussi pour nourrir la machine principale, le Trois étoiles, qui n’est pas très rentable. Toutes ces aventures extérieures, comme avec le Fouquet’s, cela me fait connaître. Je rencontre des journalistes dans le monde entier et quand ces gens viennent en France, ils vont plutôt chez Gagnaire. Tout cela est merveilleux, parce que, à moins d’être un sinistre abruti, on fonctionne à l’amour, à la tendresse et au respect… On a envie d’avancer en permanence, mais si on n’a pas un peu de renvoi, on s’étiole.

















