
Simone Zanoni – interview pour F&S au George V : « les palaces n’ont plus envie d’avoir des chefs qui ne sont pas rentables. À mon sens, la rentabilité du restaurant fait aussi partie du poste de chef. »
![]() Il est 14 heures, un mercredi ; je me presse, dans un Paris de semaine, jusqu’à l’Hôtel George V, où j’ai rendez-vous avec Simone Zanoni, le chef du restaurant George. Dès le lobby de l’hôtel, de généreuses brassées de fleurs enchantent le visiteur. Symphoniques, luxuriantes, elles annoncent les mélopées à venir des assiettes. Le chef en personne, simple et convivial, vient m’accueillir, puis me conduit jusqu’au George. Dans ce restaurant tout en longueur, les contours crème et la lumière produisent une clarté opaline ; à ma droite, un patio intérieur distille son charme onirique. L’ambiance est animée, détendue ; en ce mercredi pluvieux, le George est plein. De fait, force est de constater que cette table a de quoi plaire ; une carte alléchante, un cadre aussi préservé que cossu, et ce je-ne-sais-quoi de relax, de vif, qui rend le lieu si plaisant. Le George, un restaurant d’hôtel ? Oui, sans doute ; mais peut-être plutôt, ou tout autant, une table de quartier. D’où son succès. Une tarte Tatin m’arrive sur ces réflexions ; son croustillant généreux, le caramélisé intense et le renversant de l’ensemble me laissent ravie. Je la déguste sous l’imposant lustre Baccarat, tout en appréciant le style art-déco des lieux, et l’épaisse moquette molletonnée que foulent des fauteuils style Louis XV. Pendant ce temps, virevoltant de table en table, Simone Zanoni salue ses habitués. Les uns le remercient, d’autres lui donnent du « ciao chef », d’autres encore lui font l’accolade. Puis le chef se pose, content ; et se raconte, sans tabous ni faux-semblants. Un échange dense, nourri, à retrouver ci-dessous.
Il est 14 heures, un mercredi ; je me presse, dans un Paris de semaine, jusqu’à l’Hôtel George V, où j’ai rendez-vous avec Simone Zanoni, le chef du restaurant George. Dès le lobby de l’hôtel, de généreuses brassées de fleurs enchantent le visiteur. Symphoniques, luxuriantes, elles annoncent les mélopées à venir des assiettes. Le chef en personne, simple et convivial, vient m’accueillir, puis me conduit jusqu’au George. Dans ce restaurant tout en longueur, les contours crème et la lumière produisent une clarté opaline ; à ma droite, un patio intérieur distille son charme onirique. L’ambiance est animée, détendue ; en ce mercredi pluvieux, le George est plein. De fait, force est de constater que cette table a de quoi plaire ; une carte alléchante, un cadre aussi préservé que cossu, et ce je-ne-sais-quoi de relax, de vif, qui rend le lieu si plaisant. Le George, un restaurant d’hôtel ? Oui, sans doute ; mais peut-être plutôt, ou tout autant, une table de quartier. D’où son succès. Une tarte Tatin m’arrive sur ces réflexions ; son croustillant généreux, le caramélisé intense et le renversant de l’ensemble me laissent ravie. Je la déguste sous l’imposant lustre Baccarat, tout en appréciant le style art-déco des lieux, et l’épaisse moquette molletonnée que foulent des fauteuils style Louis XV. Pendant ce temps, virevoltant de table en table, Simone Zanoni salue ses habitués. Les uns le remercient, d’autres lui donnent du « ciao chef », d’autres encore lui font l’accolade. Puis le chef se pose, content ; et se raconte, sans tabous ni faux-semblants. Un échange dense, nourri, à retrouver ci-dessous.

F&S : Cela fait deux ans que vous êtes aux commandes du George. Un premier bilan ?
Simone Zanoni : Le restaurant marche vraiment bien. Pour vous donner un ordre d’idée, en théorie on a une capacité de 75 couverts, et on fait une centaine de couverts le soir. Ça peut aller jusqu’à 130 couverts le samedi ; on doit rajouter des tables ! Au total, on fait plus de 1.000 couverts par semaine.
F&S : Quelle était votre intention culinaire au George ?
S.Z. : Le but était de créer une table alternative, qui propose une vision différente de la gastronomie, plus globale. Notre point fort au George, c’est qu’on écoute nos clients ; on cherche à comprendre leurs attentes. Notre clientèle est décomplexée ; le côté figé de la restauration étoilée, ça ne lui plaît pas. Pas plus qu’à moi, d’ailleurs… À Londres, où j’ai travaillé 8 ans, on n’hésitait pas à déplacer les tables, même dans les restaurants 3 étoiles. Ici en France, c’est encore impensable. Tout cela, ce sont de faux complexes que se donnent les Français ; franchement, le Michelin se moque de ces choses-là. Ce qu’il regarde, c’est la qualité de l’assiette. Vous savez, la restauration connaît une grande transformation depuis ces dix dernières années ; les choses ont beaucoup changé. Au George, on veut faire partie de ce changement, de cette nouvelle offre. Comme à Londres. Or ce changement passe aussi par le fait de décomplexer le service ; c’est pourquoi ce dernier est assez cool au George. D’autant qu’on a beaucoup d’habitués ; à ce titre, le service doit être un peu plus décontracté. Et puis, un restaurant qui marche, ce n’est pas que grâce à sa cuisine ; c’est grâce à un équilibre entre la cuisine, l’esprit de l’assiette, l’expérience vécue pendant le repas, le service. Aujourd’hui, le client attend plus que juste une bonne assiette ; il cherche à vivre une histoire, quelque chose qui lui ressemble.
F&S : Parlez-nous de la clientèle du George.
S.Z. : 70% de la clientèle du George vient de l’extérieur de l’hôtel. Nous avons donc essentiellement des habitués. Ce midi par exemple, je n’ai que trois tables de l’hôtel. C’est cela notre réussite ; on a réussi à remettre du local dans le palace. Jusqu’à présent, les Français avaient déserté les palaces, car trop cher, trop guindé, pas assez rapide, etc. Ici, le service est rythmé, et l’esprit ouvert ; les clients se sentent un peu comme chez eux. De plus, ils peuvent tout à fait venir pour une salade seulement, ou pour un verre de vin. Aucun souci. Ce qui fait que j’ai des clients qui reviennent 3 à 4 fois par semaine. Et oui, nous on veut du cool ; on n’a pas à infliger des codes dans les restaurants. Le style vestimentaire lui-même a changé ; désormais, les gens viennent déjeuner en t-shirt et baskets dans les palaces (un style clean bien sûr, bien mis ; mais décontracté). Et ils y dépensent aussi bien 40 euros que 400 euros ; vous voyez, le style vestimentaire, ça ne veut rien dire. Si on n’est pas capable de suivre cette tendance, alors on passe à côté d’une grosse clientèle. L’âge, les produits, tout est différent aujourd’hui. C’est tout cela qu’on a voulu injecter au George.
F&S : En parlant de tendances, l’écoresponsabilité en cuisine a enfin le vent en poupe. Avez-vous mis en place des actions en ce sens ?
S.Z. : Tout à fait. Pour commencer, nous transformons 80% de nos déchets alimentaires en compost, via la société Les Alchimistes. Par ailleurs, nous avons créé il y a deux ans un potager pour le George, au Domaine de Madame Elizabeth dans les Yvelines. On y loue une parcelle de 3.000 m2, entretenue par 5 jardiniers. (À noter, ce potager a aussi une dimension sociale, car il permet à des jeunes défavorisés et à des personnes à la retraite ayant besoin d’un travail de se réinsérer socialement.) On y cultive des légumes, une trentaine de citronniers, 12 ruches (avec lesquelles on prévoit de produire 400 à 500 kg de miel), etc. Ce qui fait que pendant 4 mois par an, on parvient à acheter 50% de produits en moins. Et tout est bio, bien sûr. L’année dernière, on a réussi à produire 2.500 kilos de tomates ! L’autre avantage de notre potager, c’est qu’il permet de goûter et de faire des choses différentes. La troisième action, que nous venons tout juste de mettre en place, me tient beaucoup à cœur (d’autant que nous sommes les premiers à faire cela à Paris) : il s’agit du recyclage de l’eau. Au George, on jette 2.000 bouteilles par semaine ; ça fait beaucoup de verre à recycler. Du coup, j’ai voulu remplacer l’eau de bouteille par de l’eau du robinet filtrée. On fait ça avec l’entreprise Aqua Chiara. Pour conserver le style, on utilise des bouteilles en cristal faites sur-mesure. Au final, non seulement cette solution est plus responsable pour la planète, mais en plus elle nous coûtera moins cher que l’eau en bouteille. Vous voyez, on peut tout à fait créer de nouveaux business models. Cette initiative-là, c’est un point fort pour le George. Enfin, on recycle notre marc de café, avec l’entreprise La boîte à champignons, qui transforme le marc en champignons comestibles ; que l’on rachète à ce moment-là. Ce sont des cercles vertueux ; tout cela peut se mettre en place sans que la rentabilité du restaurant soit inquiétée. C’est juste une question de volonté de changement. Et parce qu’on ne compte pas s’arrêter là, on a un autre objectif écoresponsable en vue, prévu pour l’année prochaine ; on veut retirer de notre carte 60% du poisson sauvage. On le remplacera par du poisson d’élevage bio, élevé en pleine mer et nourri aux produits bio. La qualité de la chair est incomparable, et on ne met pas en péril l’équilibre maritime. Et bien sûr, je ne mettrai pas ces poissons à la carte hors saison, car sinon ça tue l’espèce. Je suis en faveur d’une pêche responsable.
F&S : La cuisine italienne se faisant à partir de produits italiens, où vous approvisionnez-vous ?
S.Z. : Deux-tiers de nos produits nous sont livrés d’Italie, dont les farines pour les pâtes. Le reste est local. Les fruits et légumes nous viennent soit du potager, soit d’Europe quand c’est possible. On fait le maximum en ce sens, en tout cas. Mais on n’est pas locavore pour autant. Par le passé, j’ai été critiqué parce que j’achète de la viande d’Australie, issue d’une ferme de la Rangers Valley qui prodigue un hectare de terrain à chaque bête ; l’animal vit dehors toute sa vie, et est nourri aux herbes fraîches. Cela donne une qualité de viande incomparable, et du point de vue éthique, le bien-être animal est respecté. Donc c’est vrai, j’opte pour cette viande-là, car je n’aime pas la manière dont sont élevées les bêtes en France. Le jour où il y aura la même qualité de viande en France, et que les bêtes y seront aussi bien traitées, pas de souci, j’achèterai tout de suite cette viande-là. En attendant, je me fournis en Australie. En plus, mes clients aiment cette viande, donc ma démarche a du sens.
F&S : Je me permets une digression : la tarte Tatin est un délice ! Le fait qu’elle soit à la carte d’un restaurant de palace, était-ce un défi ou une évidence ?
S.Z. : À mon sens, la pâtisserie française est devenue trop esthétique ; on cherche la perfection visuelle, et on perd en goût. La moitié des pâtisseries françaises sont trop travaillées, trop « belles ». Du coup, plus personne n’ose présenter une tarte Tatin dans un palace. D’autant qu’en cuisine, les jeunes ne savent pas comment on les fait … Pour ma part, cette tarte était une évidence. Chez ma grand-mère, on conservait les pommes très longtemps dans le grenier ; elles séchaient, perdaient leur eau mais pas leur goût, devenant plus concentrées en fructose. Je fais ma Tatin dans cet esprit ; cette tarte, c’est du souvenir.

F&S : Vous avez travaillé 12 ans pour Gordon Ramsay, dont 4 ans à Londres, en tant que chef de son 3 étoiles, le Restaurant Gordon Ramsay ; comment avez-vous trouvé cette destination culinaire ?
S.Z. : J’ai adoré Londres. Cette ville a une offre culinaire plus intéressante que Paris. On y mange mieux aussi, oui. Et puis, j’aime beaucoup la mentalité anglo-saxonne, avec ses façons dynamiques de faire changer les choses. J’applique cela ici en France. Ceci dit, j’aime davantage le style français. À Londres, il y a trop de frénésie ; la restauration y est très compliquée, et la main d’œuvre manque, car les loyers explosent et les restaurants sont moins rentables. Et puis, le coût du personnel va augmenter ; là-bas, on travaille 16h à 17h par jour, donc il faut embaucher plus de main d’œuvre pour réduire les horaires de chacun, ce qui augmente les coûts. Ceci dit, il y a beaucoup de choses positives à Londres ; mais pour ce qui est de l’appréciation du métier et de la reconnaissance, c’est mieux en France. D’autant qu’ici, je peux avoir une vie à côté de la cuisine, ce qui est très important. Mais bon, les Français râlent trop ; et ils voyagent peu, ce qui fait qu’ils ne se rendent pas compte de tous les avantages qu’il y a en France. En fait, j’adorerais qu’il y ait la mentalité londonienne dans un contexte français ! (Rires).
F&S : Après votre départ du Restaurant Gordon Ramsay, c’est la chef Clare Smyth qui a pris les commandes des cuisines ; elle a conservé les 3 étoiles, avant de voler de ses propres ailes, et de décrocher deux étoiles Michelin dès la première année d’ouverture de son restaurant Core. La connaissez-vous ?
S.Z. : Bien sûr, nous nous connaissons. Clare Smyth a beaucoup de personnalité, c’est une femme très forte. Le fait qu’elle ait décroché deux étoiles, cela donne une valeur ajoutée à la présence des femmes dans le métier. Elle a toutes les cartes pour réussir, et devenir une chef du futur ; elle sait mettre en valeur la cuisine anglaise, et les produits anglais. Et bien sûr, elle montre qu’on peut tout à fait être un grand chef et être une femme. Vous savez, le métier de chef est complexe ; on travaille tout le temps, sans cesse. Pour avoir des enfants, ce n’est pas toujours simple. Moi j’ai ma femme qui s’occupe des enfants, cela me permet d’avoir une carrière. Dans l’autre sens aussi, ça doit être possible. L’image de la femme ménagère est en train de disparaître ; et celle du père impliqué dans la vie de famille va se propager. Ça arrivera.
F&S : Avez-vous observé une évolution de la restauration ces dernières décennies ?
S.Z. : Oui, bien sûr. Désormais, les jeunes veulent avoir une vie à côté du travail. Pour ma part, j’ai connu la période dure de la restauration ; il y a 20 ans, c’était très compliqué de tenir dans ce métier. Il y avait des abus, des violences verbales et/ou physiques. Moi qui ai subi ça, je ne veux pas faire vivre cela aux autres ; d’autant qu’on peut obtenir les mêmes résultats avec un autre type de management. Je veux que les gens qui travaillent pour moi m’apprécient, qu’ils soient passionnés, qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, non par peur mais par passion. L’humiliation, ça ne sert à rien. Certes, on a encore l’image du chef méchant (et il y en a encore beaucoup qui le sont), mais les choses commencent à changer. Ça se ressent en salle, d’ailleurs. Et ça compte, car le travail en salle est aussi important que celui en cuisine. Il est même plus important. Vous savez, entre un restaurant avec une cuisine hors du commun mais un mauvais accueil, et un restaurant correct avec un accueil super, on choisit le second. Les chefs ont voulu prendre trop d’importance sur la scène que sont les restaurants ; or c’est un boulot d’équipe. Le rôle du chef, c’est de faire travailler tout le monde en même temps. Certains l’oublient, mais le chef fait partie d’une équipe ; un capitaine sans son équipe, il n’avance pas.

F&S : Pour vous, qu’est-ce qu’un bon chef ?
S.Z. : Le chef du futur, ce n’est pas seulement quelqu’un qui fait la meilleure cuisine ; c’est aussi quelqu’un qui s’engage dans la sauvegarde de la planète, du produit, etc. Pour ma part, je ne suis pas forcément intéressé ou désireux de faire partie du clan des grands chefs gastronomiques ; je trouve ça parfois un peu surfait. Je suis juste quelqu’un qui aime mon métier, qui veux le faire toujours mieux, et qui veux faire plaisir au client. C’est cela, le fondamental de ce métier : faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu’un d’autre. Il faut un grand sens de l’humilité pour se rappeler de cela lorsqu’on crée une assiette ; il ne faut pas la faire par égo, mais pour faire plaisir au client. Pour ma part, j’ai eu une grosse prise de conscience il y a deux-trois ans ; je me suis rendu compte que le chef du futur, ce n’est pas seulement celui qui a un restaurant qui marche bien, qui fait de la bonne cuisine, et qui est plein tous les jours. Il faut aussi que ce soit quelqu’un d’engagé, qui fasse tourner son business tout en étant respectueux de l’environnement. C’est un travail d’équilibriste. Mais c’est possible. Et c’est important que des gens connus partagent leur prise de conscience, sur la question de l’écoresponsabilité par exemple. D’autant qu’on peut déjà faire tellement de choses dans ce domaine.
F&S : Parlez-nous de votre collaboration avec Christian Le Squer, le chef du restaurant gastronomique du George V, Le Cinq. Avec lui, fonctionnez-vous en tandem ?
S.Z. : En fait, au George V il n’y a pas de chef exécutif ; donc chacun a son monde. On n’a pas voulu qu’un seul chef mette sa patte dans tous les points food de l’hôtel. Et puis, on ne peut pas faire de cuisine italienne avec un chef français. Ça n’existe pas ! (Rires). De plus, la communication du George n’est pas la même que celle du Cinq. Pour autant, ces deux tables sont complémentaires ; et on échange beaucoup Christian et moi.
F&S : Vous avez ouvert le George en 2016, et reçu une étoile en 2017. Aimeriez-vous grimper dans le Michelin ? Ou préférez-vous conserver votre liberté d’action ?
S.Z. : Je dirais que le produit que nous avons aujourd’hui n’est pas fait pour être étoilé davantage, surtout en France. Avoir 2 étoiles et un gros volume, ça n’existe pas ici. En Angleterre ou à New York, ça se fait ; ici, non. La France n’est pas prête à ça. Elle a ses notions très particulières de ce qu’est un restaurant doublement étoilé. Ceci dit, je préfère être une étoile forte, que deux étoiles faibles. Et puis, bien sûr l’étoile est très importante, mais il faut trouver sa place dans ce monde étoilé. Pour moi, ce qui compte le plus, c’est que le restaurant soit une réussite, qu’il ait un nombre important de clients au quotidien, et qu’il présente un bon équilibre économique. Un restaurant, ça ne doit pas être d’abord une histoire d’égo. Le George, je le traite comme s’il était à moi ; chaque dépense que j’y fais, je la fais comme si c’était mon affaire, comme si c’était mon propre argent que je dépensais. Je veux que ce restaurant marche toujours.

F&S : Du côté des palaces parisiens, plusieurs restaurants ont été fermés en ce début d’année ; qu’en pensez-vous ?
S.Z. : Je dirais que les palaces n’ont plus envie d’avoir des chefs qui ne sont pas rentables. À mon sens, la rentabilité du restaurant fait aussi partie du poste de chef. Ce n’est pas juste un nombre d’étoiles à atteindre (la preuve, à La Scène au Prince de Galles, ils en avaient deux, et le restaurant a quand même fermé.) Ceci dit, je ne connais pas ces chefs. Mais de manière générale, je pense qu’aujourd’hui, on doit agir comme des patrons responsables. Quoi faire pour être connu, et quoi faire pour être rentable sont deux éléments à prendre en compte de manière égale. On perd tout l’intérêt d’avoir un restaurant étoilé si ce restaurant est vide. Notre métier consiste aussi à être des gestionnaires.
F&S : On vous sait passionné de course automobile.
S.Z. : Tout à fait. Je suis une vraie pile, j’ai besoin de dépenser mon énergie. La course automobile m’oblige à me canaliser, à me calmer ; car pour aller plus vite, il faut être posé. Et puis, ce que j’aime dans cette compétition-là, c’est que le chronomètre met tout le monde d’accord. Il y a un premier, un second, un troisième, et ainsi de suite. Au contraire de la cuisine, qui est un domaine dans lequel ça n’a aucun sens de dire que tel ou tel restaurant est le meilleur du monde, car c’est très subjectif. Ce que j’aime aussi dans la course, ce sont les gens que je rencontre dans cet univers. J’aime échanger sur les passions, et non pas me retrouver encore à parler de plats avec d’autres chefs. De fait, j’ai très peu d’amis chefs, à part ceux que j’ai rencontrés dans la course automobile justement (comme Michel Sarran, qui est top, Akrame Bennalal, Jean-Edern Hurstel, ou encore Guy Savoy, qui aime beaucoup les voitures.) Quand j’ai un lien avec des chefs, c’est autour d’autres choses que de la cuisine.
F&S : En tant qu’Italien, que pensez-vous du succès de Big Mamma, le groupe de restauration italienne fondé par deux Français ? (Pour rappel, ils viennent d’ouvrir à Londres, en plus de leurs restaurants en France.) Leur business model vous paraît-il inspirant ?
S.Z. : Honnêtement, on ne peut pas dire qu’ils ne sont pas bien. Leur style de pizza n’est pas le mien, mais certaines choses qu’ils font sont très bien. Et puis, ils ont réussi à ouvrir un nouveau chapitre de la cuisine italienne, ils ont su utiliser la force de sa tradition culinaire. Cette tradition, ils la mettent en valeur et lui donnent un côté cool.
















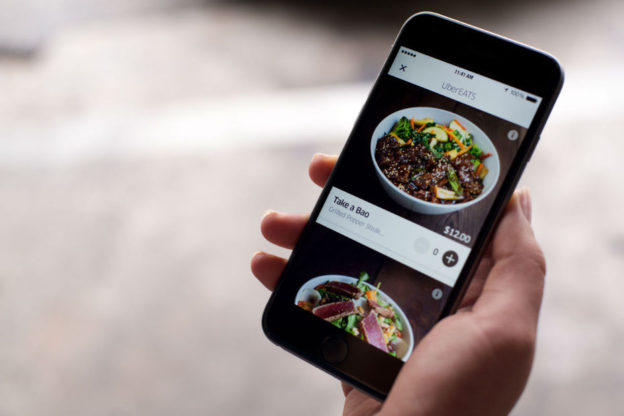


Passionnant. Et le chef est passionné tout en faisant avancer l’ecoresponsabilité dans le domaine culinaire
Bravo